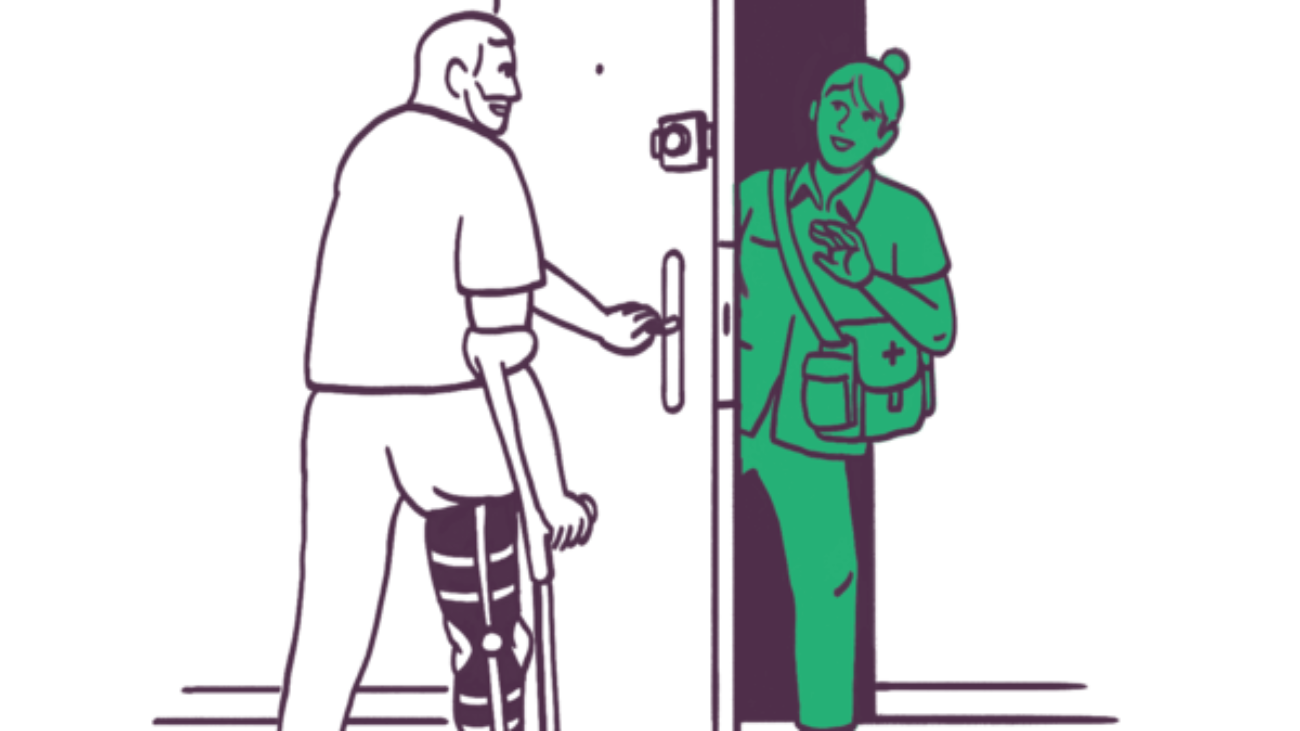Même si le gouvernement a mis en place un suivi en direct du taux de pollen journalier, vous pouvez trouver davantage de mesures pour vous préserver. Voici comment se préparer au printemps et faire face à l’allergie au pollen qui revient chaque année.

Définition de l’allergie au pollen et son impact sur la qualité de vie
L’allergie au pollen est une réaction excessive du système immunitaire au contact des éléments volatils de la pollinisation au printemps. Cette allergie est aussi appelée “ rhume des foins “ dans les cas les plus communs. En France, elle affecte près d’un adulte sur trois et 20 % des enfants de plus de 9 ans, selon l’Anses. Le pollen est transporté par le vent (pollens anémophiles) ou les insectes (pollens entomophiles). Les pollens anémophiles sont émis en grandes quantités par des plantes telles que :
- Les bétulacées : bouleau, charme, aulne, noisetier
- Les platanacées : platane
- Les fagacées : chêne, hêtre, châtaigner
- Les salicacées : peuplier, saule
- Les cupressacées : cyprès, thuya, genévrier
- Les oléacées : frêne, olivier, troène
L’allergie au pollen déclenche généralement les éternuements, une congestion nasale, des démangeaisons oculaires, une conjonctivite et de la toux. Elle peut aussi affaiblir considérablement l’immunité générale et provoquer une grosse fatigue. Ces symptômes altèrent la qualité de vie des personnes concernées. Dans les cas les plus graves, elle peut déclencher des crises d’asthme accompagnées d’essoufflements, de toux et de sifflements au niveau de la respiration.
À savoir ! N’attendez pas pour consulter : l’allergie aux pollens nécessite un diagnostic rapide. Les traitements proposés permettent de soulager rapidement les symptômes.
Se préparer pour le printemps et lutter contre l’allergie au pollen
Soulager l’allergie
Verser traiter efficacement l’allergie au pollenplusieurs approches sont envisageables, de la médecine conventionnelle aux solutions naturelles. Les antihistaminiques et les corticostéroïdes sont souvent prescrits pour soulager les symptômes. Cependant, il est parfois possible d’avoir recours à la désensibilisation (l’immunothérapie allergénique ITA). Il faudra alors réaliser un suivi chez un allergologue. Du côté des solutions naturelles, une cure de probiotiques en février et mars peut renforcer le microbiote responsable de l’immunité. Certains aliments inflammatoires comme le lactose et le gluten devraient être évités, tandis que des aliments riches en oméga-3, en vitamines E et C, ainsi qu’en probiotiques peuvent être privilégiés. La quercétine, présente dans des aliments comme le curcuma ou en gélule, peut également être bénéfique. L’utilisation d’huiles essentielles comme la lavande vraie et l’eucalyptus radié peut aider à réduire les crises d’éternuements et à dégager les voies respiratoires. Réalisez des inhalations régulières et utilisez du sérum physiologique matin et soir pour nettoyer les yeux.
Les gestes de prévention pendant le printemps
Pour appréhender le printemps, quelques gestes de prévention sont recommandés :
- À l’intérieur, il est conseillé de rincer les cheveux le soir pour éliminer le pollen, d’aérer la maison avant le lever et après le coucher du soleil. Et d’éviter les substances irritantes ou allergisantes telles que le tabac et les parfums d’intérieur.
- À l’extérieur, il est recommandé d’éviter les activités entraînant une sur-exposition au pollen, comme la tonte du gazon. Privilégier le début ou la fin de journée pour les balades en nature. Le port de lunettes de protection et de masque peut également être utile. S’attacher les cheveux permet d’éviter que le pollen s’y dépose. Pour finir, maintenir des vitres de voiture fermées lors des déplacements.
Les causes d’une augmentation des allergies printanières
Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, la moitié de la population sera touchée par l’allergie au pollen en 2050, en raison du changement climatique et de la pollution atmosphérique. La pollution urbaine augmente la toxicité des pollens en fragilisant leur surface et en libérant des volatiles plus allergisants. La météorologie influence également la pollinisation, avec des variations liées à la chaleur, l’humidité, les pluies et le vent. Le réchauffement climatique contribue à des saisons polliniques précocesplus intenses et plus longues. Les allergies n’affectent plus uniquement les personnes atopiques (les personnes prédisposées génétiquement à l’allergie) mais plus largement la population générale. Cette augmentation repose aussi sur les modifications du paysage urbain qui favorisent l’apparition d’espèces allergisantes. En effet, la plantation d’arbre allergisant et la sélection des espèces a créé un climat allergisant dans les villes. Ailleurs, c’est le manque de diversité qui provoque des séquences allergisantes plus importantes.
Sources