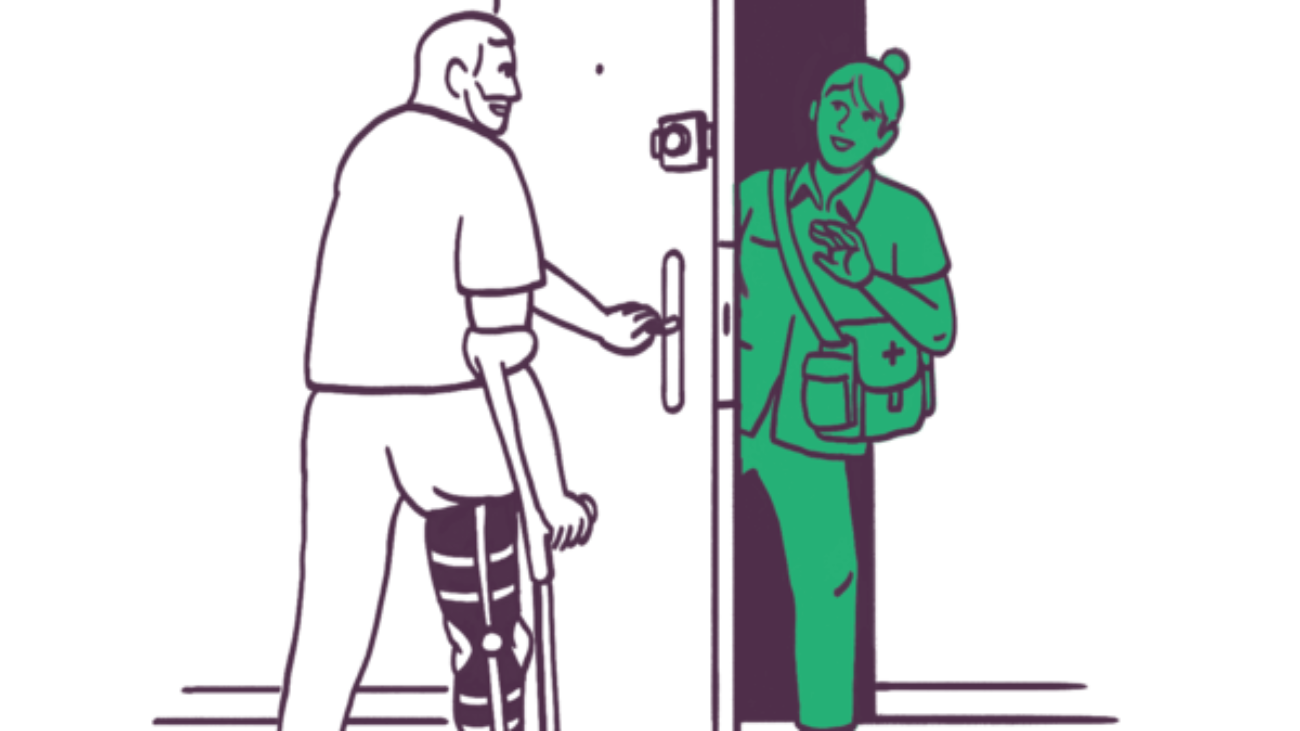A l’heure actuelle, le corps médical ne dispose d’aucun médicament pour aider à améliorer l’état des patients se trouvant dans le coma. Publiée dans la revue Cerveauune récente étude toulousaine est néanmoins porteuse d’espoir. Elle est en effet parvenue à mettre en évidence chez des patients dans le coma des zones du cerveau touchées par des inflammations. Cette étude inédite est ainsi porteuse d’espoir pour la prise en charge des patients dans le coma. On fait le point.

Une prise en charge « passive » des patients dans le coma
Le coma désigne la perte rapide et complète de la conscience d’un individu provoquée par une agression cérébrale sévère. Il peut s’agir :
- D’une agression cérébrale traumatique (comme un traumatisme crânien).
- Ou d’une agression cérébrale anoxique (suite à un arrêt cardiaque par exemple le cerveau n’est plus alimenté en oxygène et cesse son activité).
Associé à une mortalité significative, le coma fait l’objet d’une récupération variable et peut être à l’origine d’handicaps neurologiques considérables.
A l’heure actuelle, le corps médical ne dispose d’aucun médicament efficace pour faciliter le retour à la conscience des patients se trouvant dans le coma. Les médecins réanimateurs s’en tiennent donc à une prise en charge qu’ils qualifient de « passive ». Ils font en sorte de maintenir les fonctions vitales du patient dans le coma et de l’accompagner en attendant une récupération neurologique spontanée.
La communauté scientifique sait que la conscience n’est pas localisée dans une zone précise du cerveau mais qu’elle se distribue à travers un large réseau de communication entre neurones. Or, ce réseau de communication neuronale ne fonctionne plus chez les patients dans le coma. Il semble dès lors essentiel de comprendre les raisons de ce dysfonctionnement. Des équipes de médecins du CHU de Toulouse et de chercheurs Inserm ont suggéré que les mécanismes de l’inflammation cérébrale chez les patients dans le coma pourraient être en cause. Ils ont ainsi mis sur pied une étude inédite pour le vérifier.
Lien entre inflammation cérébrale et coma
Pour mener à bien cette étude inédite, les scientifiques ont constitué une cohorte en y incluant dix-sept patients entre 2018 et 2022. Onze d’entre eux se trouvaient dans le coma suite à un accident traumatique, et six d’entre eux se trouvaient dans le coma après une anoxie. Tous hospitalisés en réanimation au CHU de Toulouse, ils ont passé un examen d’imagerie TEP-scan.
À savoir ! Le TEP Scan désigne une technique innovante d’imagerie moléculaire in vivo réalisée par émission de positons.
Cet examen d’imagerie moléculaire a consisté à utiliser un radiotraceur (18F-DPA 714) se fixant sur des cellules immunitaires spécifiques du cerveau appelées « cellules microgliales ». Dans des conditions inflammatoires, ces cellules se modifient et le radiotraceur permet donc de localiser l’inflammation et d’en mesurer l’intensité.
Pour la première fois, les scientifiques ont pu observer par imagerie les niveaux d’inflammation du cerveau des patients dans le coma. En les comparant aux clichés de personnes en bonne santé, ils ont pu dresser les constats suivants :
- Présence d’une inflammation cérébrale significative au niveau des zones du cerveau impliquées dans le traitement des informations conscientes.
- Selon l’origine du coma (traumatisme ou anoxie), les zones d’inflammation sont différentes en termes d’intensité et de localisation.
Vers une meilleure prise en charge des patients dans le coma ?
Publiés dans la revue Cerveauces résultats inédits sont une première in vivo et apportent un nouvel éclairage quant au rôle de l’inflammation cérébrale dans le coma. Ils livrent ainsi au monde scientifique des renseignements précieux pour mieux comprendre la grande hétérogénéité des profils de récupération des patients dans le coma. Ces résultats sont également porteurs d’espoir car ils ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques et d’évaluation pronostique de la récupération des patients.
Forte de ces premiers résultats, l’équipe de scientifiques envisage de mener une étude de phase 2 sur un panel plus important de patients. Cette étude serait plus complète car elle associerait des mesures biologiques aux résultats d’imagerie avec pour objectif final de tester des médicaments contre l’inflammation. Nul doute que ces travaux permettront une avancée majeure dans la stratégie de prise en charge des patients dans le coma. Affaire à suivre !
Déborah L., Dr en Pharmacie
Sources
– Coma : une étude en réanimation sur l’inflammation cérébrale ouvre des perspectives prometteuses.www.lequotidiendumedecin.fr. Consulté le 19 mars 2024.